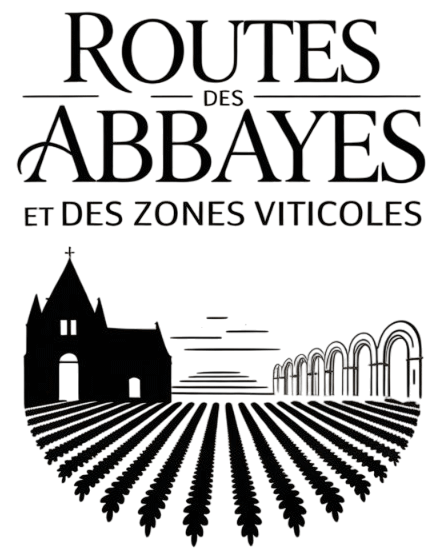Périgord médiéval : les bastides et villages qui façonnent l’histoire de la Dordogne
Au cœur de la Dordogne, les bastides et villages médiévaux s’imposent comme les témoins indélébiles de l’histoire tourmentée du Périgord. Entre guerres franco-anglaises, envolée économique et organisation urbaine innovante...