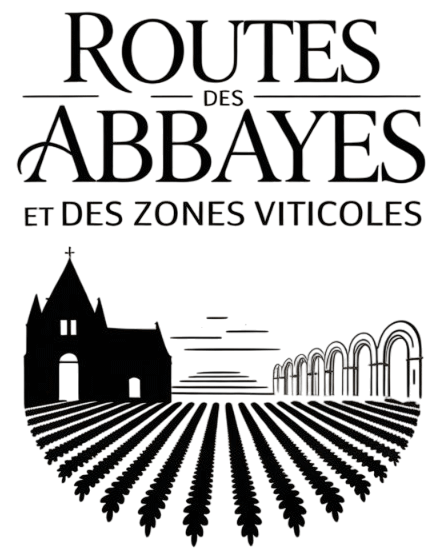Castelnaud : chef-d’œuvre de la fortification médiévale en Dordogne
En Dordogne, le château de Castelnaud-la-Chapelle s’élève sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Dordogne et surveillant les voies d’accès entre Sarlat, Beynac et le pays de l’Agenais. Bâti à partir...