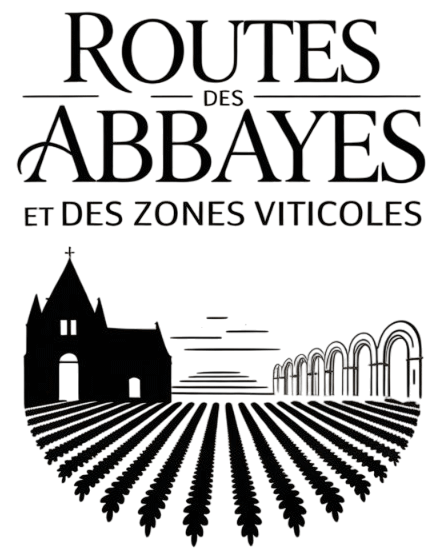Voyage au cœur des châteaux d’exception : le Périgord révélé par ses forteresses
Avec près de 1 001 châteaux recensés (source : Comité Départemental du Tourisme Dordogne-Périgord), la Dordogne détient le record national de concentration de châteaux. Cet héritage remonte aux rivalités médiévales, quand l...