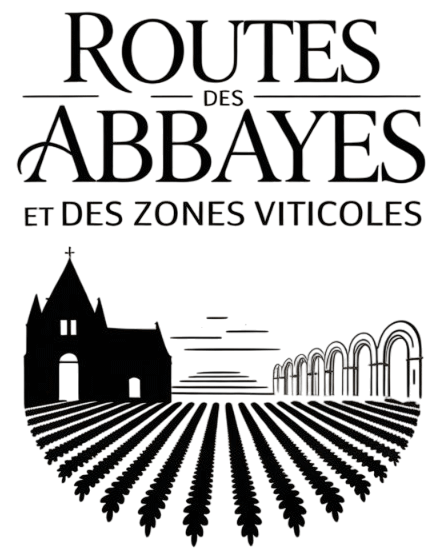À la découverte des abbayes de Dordogne : héritage, beauté et fascination
La Dordogne, souvent louée pour ses paysages et ses bastides, doit aussi sa renommée à ses abbayes, témoins silencieux d’une époque où le sacré dictait l’organisation de la société et façonnait les territoires. V...