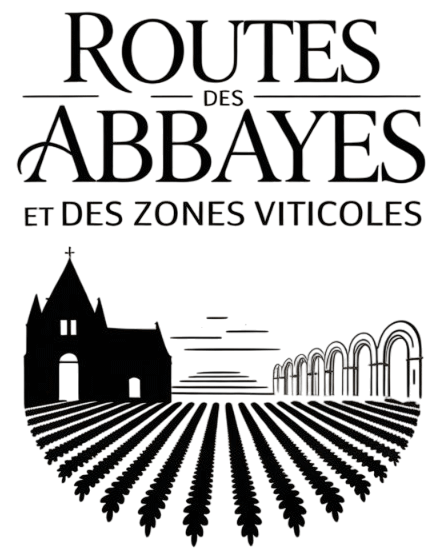Le château de Beynac : sentinelle de la Dordogne et emblème de la guerre de Cent Ans
Dirigé depuis l’à-pic de sa falaise, le château de Beynac, dominant la Dordogne de plus de 150 mètres, frappe d’emblée par sa position spectaculaire. Mais au-delà de sa beauté, il incarne la tension constante entre Anglais...