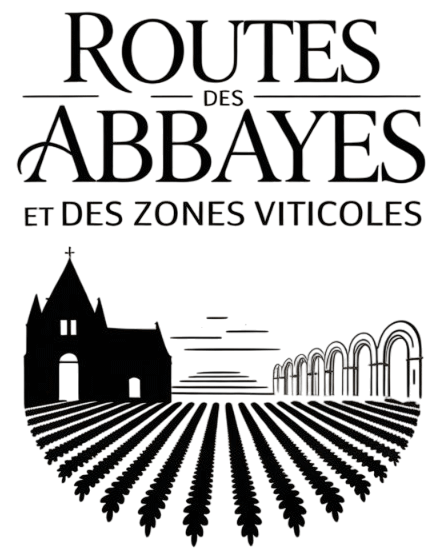Quand la vigne se fait prière : l’influence des abbayes de Dordogne sur la tradition viticole
La Dordogne, jadis Périgord, évoque instantanément châteaux, villages médiévaux et rivières sinueuses. Pourtant, avant d’être un haut-lieu touristique, la région fut le berceau d’une cohabitation unique entre spiritualité et exploitation des...