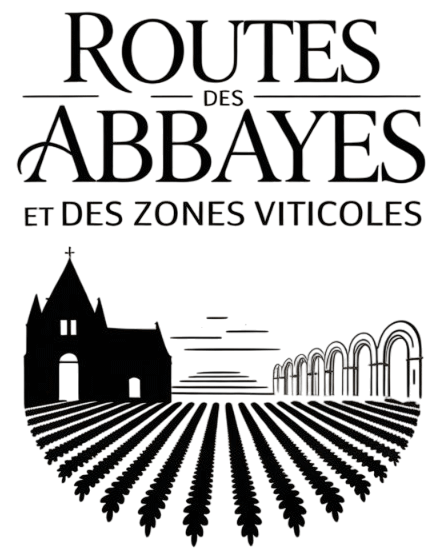Le cloître de Cadouin : chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant, classé à l’UNESCO
Aujourd’hui, Cadouin est mondialement connue pour son cloître, classé patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Construit entre 1490 et 1512, le cloître succède à un ensemble roman plus ancien disparu. Le chantier dura près de vingt-cinq ans, initié sous l’abbatiat de Jean d’Authon.
Ce cloître frappe avant tout par l’élégance et la finesse de son décor sculpté : deux galeries s’ouvrent sur des arcs brisés fleuris, soutenus par des colonnettes torsadées, où l’on repère les motifs emblématiques du gothique flamboyant. Fleurons, frises végétales, animaux fantastiques et figures humaines singulières s’y côtoient, laissant deviner influences hispano-mauresques dans certains détails (voir Aurélie Trottier, "Cloîtres du Sud-ouest", Edition Sud-Ouest).
- Période de construction du cloître actuel : 1490-1512
- Maçon principal : Jean Ferrier, maître d’œuvre de Sarlat
- Dimensions : près de 30 mètres de côté (soit 900 m²)
- Statut UNESCO : inscrit comme site clé sur les Chemins de Compostelle depuis 1998 (voir UNESCO)
Au fil de la journée, le jeu de la lumière sur la pierre dorée confère au lieu une atmosphère toute particulière, propice à la méditation autant qu’à la contemplation artistique.
Une architecture sculptée, reflet des sociétés médiévales
La décoration du cloître multiplie les références aux cycles bibliques (Adam et Ève, lions, griffons), mais aussi aux métiers de la région. C’est dans ces modillons parfois facétieux que s’esquisse le quotidien des tailleurs de pierre, des paysans, des vignerons locaux. Certains chapiteaux, très expressifs, évoquent des scènes burlesques témoignant de la vivacité de l’imaginaire populaire au tournant du XVe siècle.