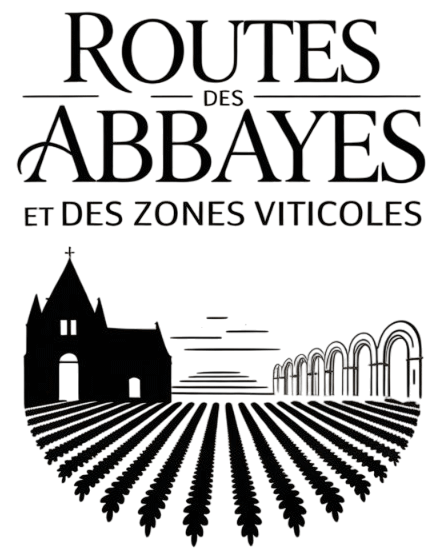Les grandes abbayes de Dordogne : trésors d’histoire, d’art et de spiritualité à explorer
La Dordogne, cœur battant du Périgord, n’est pas seulement le pays des châteaux et des bastides. Son maillage d’abbayes témoigne d’un passé religieux intense, où moines bénédictins, cisterciens, augustins et chartreux...