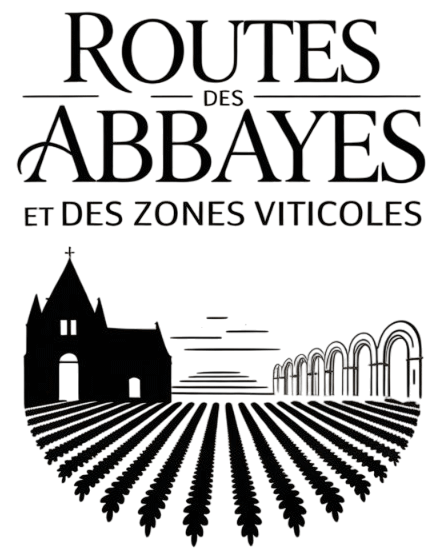Pourquoi associe-t-on le château de Montaigne à la littérature ?
Michel de Montaigne : une figure tutélaire des lettres françaises
S’il est un château indissociable de la littérature française, c’est celui-ci. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) demeure un des penseurs les plus influents de la Renaissance, fondateur de l’essai moderne et humaniste engagé. Dès la publication du premier livre des « Essais » en 1580, la tour qu’il appelle, non sans malice, sa « librairie », devient le symbole du dialogue intime entre l’auteur et le monde. C’est dans ces murs qu’il consigne ses réflexions, jour après jour, au fil de ses lectures d’auteurs antiques et des grands humanistes européens.
- Les « Essais » furent écrits entre 1572 et 1592, révisés sans cesse jusqu’à la mort de l’auteur.
- L’œuvre constitue environ 1 000 pages, traduites ou étudiées dans plus de 40 langues (source : Bibliothèque nationale de France).
La « librairie » : une pièce mythique au service de la pensée
La bibliothèque privée de Montaigne fut, dès son origine, un espace unique : elle accueillait plus de 1 000 volumes (un chiffre considérable pour la fin du XVI siècle), allant de la philosophie gréco-romaine aux textes de la Réforme protestante, de la poésie à la médecine. La singularité de ce lieu tient à l’inscription, par Montaigne lui-même, de sentences, maximes et citations sur les poutres : « Ce n’est pas un musée : c’est l’atelier d’un penseur, où les murs sont tapissés de répliques qui l’accompagnent dans ses méditations », écrit encore l’historien Philippe Desan (source : « Montaigne. Une biographie politique », Gallimard, 2020).
- Ce dispositif de « poutres annotées » a inspiré de nombreux auteurs, de Pascal à Virginia Woolf.
- La librairie est classée « Lieu de Mémoire Européen » depuis 2002 (Conseil de l’Europe).
Des visiteurs illustres et des écrivains sous le charme
Au fil des siècles, la tour attira des figures aussi diverses que Montesquieu, Chateaubriand, Malraux ou, plus récemment, Milan Kundera. Pour nombre d’entre eux, la visite de la pièce d’écriture fut un acte quasi initiatique :
- Montesquieu s’en inspira pour concevoir La Brède, sa propre « tour d’étude ».
- Gide décrivit sa visite comme « l’expérience d’une intimité intacte avec un esprit du passé ».
Ce rayonnement perdure aujourd’hui, animant colloques et séjours littéraires, transformant le site en un centre vivant de recherche et de dialogue intellectuel.