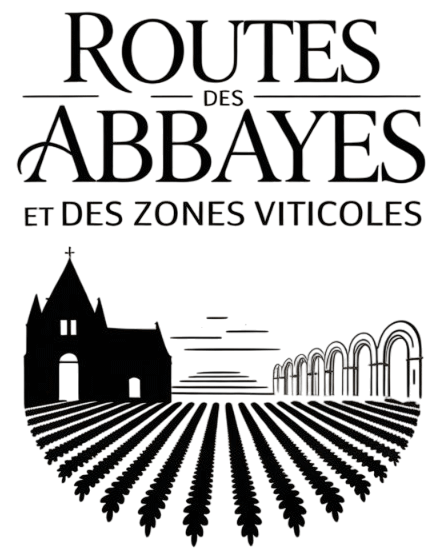Le mystère séculaire des bastides du Périgord : voyage au cœur d’un urbanisme unique
Au XIII siècle, le Sud-Ouest de la France devient le théâtre d’une expérience inédite d’urbanisme : la fondation de bastides. Face à la rivalité entre le roi de France et le roi d’Angleterre, ces nouvelles...